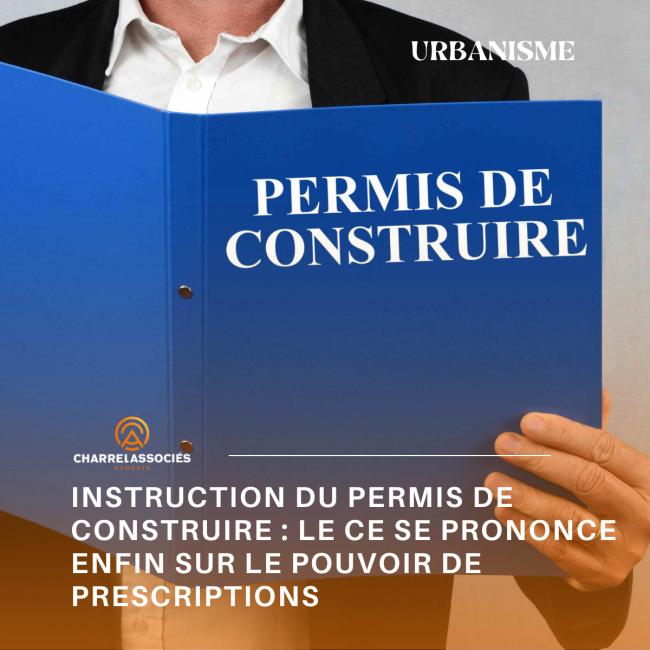Pour rappel, le 8 novembre 2024, le Tribunal administratif de Toulon a saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis (voir article précédent) dans le cadre de l’affaire AEI Promotion (TA Toulon, 8 novembre 2024, n° 2400101) pour éclaircir le régime du pouvoir de prescriptions en matière d’instruction de permis de construire.
La question du TA était la suivante :
« Un pétitionnaire qui, en dehors de toutes dispositions législatives et réglementaires prévoyant la possibilité pour l'autorité compétente d'assortir son autorisation d'urbanisme de prescriptions spéciales, se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable, peut-il se prévaloir, devant le juge, de ce que, bien que son projet méconnaisse les dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, cette dernière aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l'assortissant de prescriptions ? »
La prescription est une notion qui n’a été définie par aucun texte législatif ou règlementaire bien qu’il en soit fait mention à plusieurs reprises dans le Code de l’urbanisme.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle qu’un permis de construire ne peut être accordé que dans le cas où le projet est compatible aux dispositions en vigueur comme prévu par l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme.
Il mentionne ensuite que des prescriptions peuvent être imposées en cas de déclaration préalable comme l’explique l’article L. 421-7 du même Code.
Enfin, le juge de cassation rappelle que l’article L. 424-1 du même Code précise :
« L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. » (…)
A l’aune de l’ensemble de ces dispositions, le juge de cassation explique que l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme doit refuser les demandes ne respectant pas la règlementation applicable. Il rappelle ensuite que si la demande d’urbanisme ne respecte pas ces règles, le pétitionnaire, après que le service instructeur lui ait fait part des manquements du projet, peut modifier son projet durant la phase d’instruction du dossier. Ces modifications ne doivent pas changer la nature du projet.
Enfin, le Conseil d’État se prononce sur la question posée par le TA.
Il explique que le pouvoir de prescriptions n’est qu’une faculté pour l’autorité compétente, elle n’est pas tenue d’en faire usage.
Il est toutefois précisé, par cet avis, que les prescriptions ne peuvent qu’entrainer des modifications précises et limitées du projet ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet. Ces modifications du projet doivent avoir pour but d’assurer la conformité des travaux projetés à la règlementation applicable.
De plus, le Conseil d’État explique que le pétitionnaire qui s’est vu refuser sa demande d’urbanisme ne peut se prévaloir, devant le juge, du fait que l’autorité compétente n’ait pas mis en œuvre son pouvoir de prescriptions spéciales, alors même que son usage aurait pu éviter un refus de la demande.
Voilà qui devrait mettre un terme au foisonnement jurisprudentiel et lisser l’interprétation en la matière.
Si l’obligation de faire usage du pouvoir de prescription lorsque les irrégularités sont marginales aurait nécessairement engendré une charge de travail supplémentaire significative pour les services instructeurs, elle aurait tout de même pu permettre de limiter le contentieux des autorisations d’urbanisme.
En outre, cette position jurisprudentielle pourrait, en laissant le choix à l’autorité compétente de faire usage ou non de cette faculté, créer une rupture d’égalité entre les pétitionnaires.